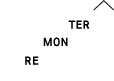Dans ce texte, publié dans “Contemporary African Photography from the Walther Collection. Appropriated Landscapes” et édité par Corinne Diserens (The Walther Collection/Steidl, 2011), Penny Siopis revient sur le parcours de Dimitrios Tsafendas, figure controversée de l’histoire identitaire d’Afrique du Sud dont elle tente de retracer une biographie visuelle imaginaire dans son film « Obscure White Messenger ».

« Obscure White Messenger » de Penny Siopis sera présenté avec une sélection de ses autres court-métrages au Jeu de Paume le vendredi 15 Novembre à 18H30 dans le cadre du cycle « Possessions »
Le 6 septembre 1966, alors que le Premier Ministre d’Afrique du Sud Hendrik Verwoerd s’apprêtait à prononcer un discours devant la Chambre de l’Assemblée, un messager parlementaire le blessa à mort avec un large couteau de cuisine. Ce messager était Dimitrios Tsafendas. Placé sur liste noire et connut en tant qu’étranger à tendance communiste, Tsafendas n’aurait jamais dû être autorisé à pénétrer sur le territoire sud africain. Métis et apatride, il n’aurait pas non plus dû être nommé messager parlementaire, une position réservée aux sud-africains blancs. L’ensemble était donc une erreur.
Tsafendas était pour ainsi dire “illégitime” dès l’origine. Son père, Michaelis, était né en Crête, s’installant par la suite à Lourenço Marques où il travailla en tant qu’ingénieur. Il employait alors comme domestique une femme noire prénommée Amelia Williams. Cette dernière devint rapidement l’amante de Michaelis, et Dimitrios naquit de cette union en 1918. Peu de temps après sa naissance, Amelia quitta le domicile familial et n’y revint jamais. Dimitrios fut enregistré sous le nom de son père et baptisé dans la tradition grecque orthodoxe. Peu de temps après, Michaelis épousa une femme grecque. Dimitrios, qui était alors un enfant difficile au regard sombre, devint une entrave à cette relation. Il fut donc confié à sa grand-mère qui vivait à Alexandrie, en Egypte. Il y vécut la seule période heureuse de sa vie. Lorsque sa grand-mère tomba malade, il fut renvoyé à Lourenço Marques. Une fois encore, sa présence posa problème. Son père et sa nouvelle femme avaient construit une famille dans laquelle il n’avait plus sa place. Il fut donc envoyé dans un pensionnat d’Afrique du Sud, situé dans la ville de Middleburg. Les quelques années passées dans cette école lui firent prendre conscience de ce qu’était le racisme. Ses camarades de classe le prénommaient “Blackie”. Il finit par quitter le pays.
Dimitrios passa la majeure partie de sa vie en mer, tant au sens propre qu’au sens figuré. Il vécut dans divers pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient où il séjourna en hôpital psychiatrique ou en prison, il enseignait l’anglais tout en faisant des petits boulots. Il parlait de nombreuses langues et travailla occasionnellement en tant que traducteur. Il était malgré tout un homme étrange. Un étranger. Un marginal. Ses opinions politiques ne plaidèrent pas sa cause. Aucun pays n’accepta de lui accorder la citoyenneté, pas même celui qui l’avait vu naître.
Tout au long de sa vie, il tenta de retourner en Afrique du Sud. A quelques occasions, il réussit à s’y rendre mais fut rapidement expulsé. Cela semblait être son destin. L’ Afrique du Sud devint pour lui une obsession. Il associait ce pays à sa mère. D’autre part, la seule femme qui désira l’épouser était sud-africaine. Le mariage était impossible cependant, car cette femme était “de couleur” et, sous l’apartheid, les relations sexuelles entre blancs et noirs étaient interdites par la loi. Dimitrios avait par erreur était catégorisé “blanc”. Pour se marier avec cette femme, il devait donc changer de catégorie. Son dossier de demande était toujours sur le bureau du gouverneur lorsqu’il assassina Verwoerd. Le fait qu’il ne puisse épouser la femme qu’il aimait attisa sa haine envers les lois sud-africaines, en matière de ségrégation raciale. Cette haine l’aurait-il poussé à commettre un homicide?
Selon l’enquête, c’est la folie, et non la politique, qui l’aurait guidé dans son acte. Il a été déclaré inapte à passer en jugement, le juge-président du Cap, Juge Beyers, déclara: « Je ne peux pas plus juger un homme dépourvu de toute pensée rationnelle qu’un chien ou qu’un objet. C’est un être qui a perdu la raison.»
La folie de Tsafendas aurait été générée chez lui par le Ténia dont il fut atteint lorsqu’il était enfant. Ce ver l’aurait poussé à agir ! La combinaison d’un état de démence et d’une opinion politique, comme fondements de cet acte, ne semblait pas convaincre l’ Etat d’apartheid, ni même le public. Les médias évoquèrent largement le ténia et la folie, mais peu l’aspect politique.
Tsafenda fut incarcéré à la prison centrale de Pretoria durant plus d’un quart de siècle, pour le plus grand plaisir du juge-président. Il passa la majeur partie du temps dans le couloir de la mort, sa cellule étant adjacente à l’espace de pendaison, où sept exécutions pouvaient avoir lieu à la fois. S’il n’était pas dément lorsqu’il a assassiné Verwoerd, cette expérience, ainsi que les abus répétés des gardiens de prison, l’auraient bel et bien plongé dans la folie. En 1994, qui fut l’année de la première élection démocratique en Afrique du Sud, il fut libéré et placé dans un asile psychiatrique à Sterkfontein. Il y décéda dans un relatif anonymat en 1999.
Nelson Mendela surnomma Tsafendas « le mystérieux messager blanc ». Il n’était pas blanc et son rôle de messager était un erreur, mais son acte marqua l’Histoire et en changea le cours.
La plupart des sud-africains de ma génération se souvienne de l’annonce du meurtre de Verwoerd. Elle fut un choc immense et apparut comme une préfiguration de l’effondrement de la “nation” Verwoerd, l’architecte de l’apartheid. Un terrible anniversaire célébrant les cinq ans de la nouvelle république d’Afrique du Sud.
La population blanche pleura la perte de son leader. Tout comme certains noirs. Les journaux se déchaînèrent. Les drapeaux étaient en berne. Le monde « civilisé » exprima ses condoléances. Personne ne toléra ce meurtre, quel que soit son opinion sur l’apartheid. Mais certains se réjouirent malgré tout, comme mon amie Nora. Nora s’empressa de répandre la nouvelle au sein de notre internat catholique, traversant les couloirs, les cloitres, et même les sanitaires. Elle hurlait « Verwoerd est mort. Mort. Mort. Mort. Ouais »
Je me trouvais dans la salle de bain du couvent, prenant une douche suite un match de hockey acharné. Je me souviens avec précision de la porte valsant, de Nora criant, et de la religieuse lançant « Silence mon enfant, vous ne devriez jamais vous réjouir de la mort d’un homme ». Ce à quoi Nora répliqua « Vous savez qu’il était un mauvais homme ». La religieuse lui répondit « Mais c’est contraire à l’attitude chrétienne de se réjouir du malheur des autres. »
J’avais treize ans à cette époque. Bien que mon père voyait l’assassinat de Verwoerd comme une aubaine politique, mes parents semblaient moins intéressés par l’attitude à adopter face à cette mort, que par la nationalité grecque de Tsafendas. Ma mère était moitié grecque, moitié sud-africaine, et mon père était un citoyen grec. Quel genre de grec ferait une chose pareil? Qui était-il d’ailleurs? Personne parmi la communauté grecque ne le connaissait. Mais beaucoup de propriétaires grecs de cafés accrochaient des photos de Verwoerd dans leur commerce pour indiquer de quel côté ils se trouvaient. Peut-être avaient-ils peur des représailles. Leurs craintes n’étaient pas infondées. La nationalité grecque de Tsafendas fut mise en avant dans les médias, la presse n’évoqua que très succinctement ses racines africaines. Parler de cet acte comme de celui d’un fou et non d’un agitateur « noir » était sans aucun doute plus politiquement correct. Aux yeux des partisans de la suprématie raciale blanche, qui idéalisaient la blondeur et les yeux bleus du nord, les grecs étaient les rebuts de l’Europe du Sud.
Beaucoup d’autres s’intéressèrent à Tsafendas. Les journalistes allaient sur le terrain, interrogeaient les personnes l’ayant connu et relataient leurs histoires, bien que personne ne semblait le connaître vraiment. Sa propriétaire se souvenait du désordre et de l’étrangeté qui le caractérisaient. L’un des reporters expliqua qu’il était interdit de prendre des photos des affaires de Tsafendas qui se trouvaient dans sa chambre de Rondebosch à Cape Town. Cette courte histoire me captiva. Le détail, la tristesse suggérée, et le pouvoir des mots lorsque les images manquent.
Tout ceci, et plus encore, a alimenté mon film qui revisite cette étape de l’Histoire sud-africaine, dite « le Mystérieux Messager Blanc ». J’ai exploité et assemblé des extraits de films anonymes, combinant ces séquences avec divers sons et mots. Certains films ont été tournés en Afrique du Sud, d’autres en Grèce, et quelques-uns dans des endroits non identifiés à ce jour. La bande sonore est une musique traditionnelle turque. Pour le récit, j’ai puisé dans l’examen psychiatrique de Tsafendas réalisé juste après l’assassinat (basé sur un corpus de questions-réponses), ainsi que dans un ensemble de rapports médicaux, récits médiatiques, documents officiels et dans le film documentaire A Question of Madness (1998) réalisé par Liza Key. J’ai également utilisé l’ouvrage A Mouthful of Glass (2000) de Henk van Woerden, décrit par Christopher Hope, journaliste à l’Independent, comme « un savant mélange d’éléments biographiques et de d’émerveillement ».