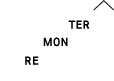Longtemps j’ai cherché à nommer, comme d’autres, ce qui me semblait – et me semble aujourd’hui encore – spécifique dans les émeutes des quartiers populaires qui ont agité la France durant les mois d’octobre et novembre de l’année 2005. La mort de deux jeunes à Clichy-sous-bois, en région parisienne, avait provoqué à l’époque un embrasement sans précédent des banlieues de plusieurs grandes villes de l’Hexagone, portant l’évènement en Une de la presse nationale et internationale.
Si les circonstances tragiques du décès de ces adolescents, poursuivis par la police, venaient renforcer un motif tristement récurrent dans l’histoire contemporaine de l’émeute, s’attarder quelque peu sur la nature particulière de cet évènement me semblait nécessaire pour étudier sa dynamique, son vocabulaire propre et peut-être, c’est l’hypothèse qui traverse cette ébauche, son appartenance à une histoire innommable.
Comment saisir ce surgissement ? Et plus encore le recevoir ? Comment faire corps avec lui et en recueillir le savoir ? Poser l’émeute comme principe secret de transmission et non comme rupture d’un ordre social établi était alors la base de mon projet. Essayer par là-même de considérer des régimes multiples et simultanés de l’Histoire dont l’émeute serait un moment fugace de perception, aperçu par un trou dans l’écran des récits dominants. En cela, il me semblait nécessaire de relier les émeutes de 2005 à une certaine conception de l’histoire coloniale – un trafic des noms (1) – dont je me dois ici d’éclairer le chemin tortueux qui propose un usage particulier de la sorcière.
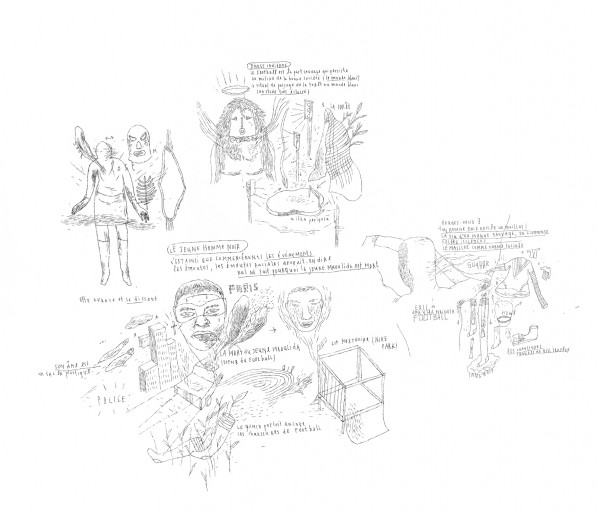
S’il m’a fallu un certain temps pour donner corps à quelques hypothèses relatives à ces émeutes, ce n’est pas du fait de la nature proprement sidérante de leur apparition, mais bien parce qu’il me semblait nécessaire – et il a été longtemps difficile de le faire entendre – de s’intéresser de plus près au corps de l’évènement lui-même, à ce qui s’y passe ; ce qui a été souvent assimilé lors de discussions passionnées à une fascination malsaine pour la violence voire à un manque de compassion pour la souffrance sociale dont l’émeute serait l’évidente manifestation.
Dans les faits, les outils critiques convoqués pour saisir ces troubles opèrent tous, quels qu’en soient les objectifs et les obédiences d’une mise à distance de l’évènement lui-même, de ce qu’il contient comme sens propre. Dans ce contexte précis, placer l’émeute au bout de la chaîne d’un schéma sociologique éprouvé, comme point culminant des exaspérations populaires, n’est pas suffisant. L’imaginer comme geste proto-politique – c’est-à-dire comme parole inarticulée à partir de laquelle il s’agirait de produire un savoir et un discours a posteriori – c’est faire économie de l’expérience immédiate qu’elle propose, c’est ignorer le monde muet et invisible que ce moment particulier permet d’apercevoir et dont les corps des jeunes habitants des quartiers populaires seraient les plaques sensibles (2).
Les acteurs dominants de la société – les hommes politiques en premier lieu – s’empressent cependant de refermer l’évènement, de le traiter comme le symptôme d’un corps malade auquel chacun administre ses remèdes. La difficile médiation de l’évènement nous heurte, comme l’opacité qu’il oppose aux analyses à distance et l’engagement du corps qu’il réclame pour accéder au savoir. Son statut de performance forme un régime d’intelligence parallèle qui retient ici toute notre attention – nature toute autre que celle de la manifestation, nous le verrons plus loin, même si une analyse plus fine restera à développer à l’endroit de certains aspects les plus radicaux du carnavalesque qui contiennent eux aussi des promesses de transfiguration du quotidien dans un registre transgressif.
Bien sûr comme souvent, du côté conservateur de l’échiquier politique, ces émeutes n’ont pas laissé indifférent. Les exercices de l’insulte dont certains sont devenus salariés ont rempli la scène médiatique, allant chercher dans des foyers démissionnaires et polygames, dans des sous-sols où se côtoient tournantes et prières islamiques, le scénario d’une fiction contemporaine dont les liens avec les mythes coloniaux doivent nous alerter. Ainsi les désordres nocturnes de ces « sauvageons » (3) ne manqueront pas d’alimenter notre réflexion qui commence par l’endroit le plus problématique et le plus prolifique de l’évènement : ce qu’il contient d’innommable.
De l’innommable.
L’émeute appartient par définition à une catégorie d’évènements difficiles à nommer. Elle surgit sans prévenir. En cela, elle s’éloigne radicalement des principes de la manifestation qui dans sa forme contemporaine s’est muée en un dispositif prédéfini d’annonces : parcours, mots d’ordre, fréquentation. L’émeute se soustrait en tous points à ce type de mobilisation – autant dans sa forme que dans l’horizon abstrait de la lutte. La tentation est grande de la subordonner alors à des principes de causalité et à ainsi l’organiser selon des catégories signifiantes – émeutes de la faim, émeutes anti-gouvernementales… Mais même dans cette économie de pensée, « l’émeute de banlieue » reste une définition sans épaisseur et le terme de « révolte des quartiers populaires » une fantasmagorie qui tente de juguler le vide que creuse justement cette situation particulière dans le sens commun.
L’émeute (s’)échappe. Elle apparaît sans prononcer son projet et disparaît sans laisser de trace. Nul discours ne la précède et dans le registre qui nous intéresse ici, nulle revendication ne s’y prononce. À ce moment de l’analyse, il est peut-être nécessaire de nous concentrer sur cette absence, cette stratégie du vide qui contraste avec la puissance visuelle que convoque l’évènement. S’il semble possible de souligner une dimension particulière des révoltes de banlieue depuis le seuil des années 80 dans l’histoire contemporaine des émotions populaires (4), c’est qu’ici l’évènement dans sa forme fait directement écho aux populations innommables qui en sont les acteurs et c’est pour cette raison qu’il est indispensable de replacer cette situation dans une perspective coloniale pour lui donner une nouvelle épaisseur.
Comme je l’ai souligné dans des textes précédents (5), l’acte de nommer est l’un des protocoles du projet colonial qui me semble des plus significatifs. Nommer est une manière de faire sortir des ténèbres, de mettre en lumière, de rendre intelligible quitte à nommer par-dessus.
On se rappellera que des périodes coloniales les plus anciennes aux épisodes les plus récents, la disparition des noms du colonisé – des territoires, des rues comme des personnes – compose en soi un mode de domination et la renomination un principe de saisie. Qu’il s’agisse de la transmission patronymique du maître vers l’esclave affranchi ou de l’escamotage des noms dans l’état civil de l’Algérie française, pour ne citer que deux exemples, il convient d’apercevoir ici une entreprise complémentaire de celle du projet moderne du colonialisme qui repousse par ailleurs les savoirs, les pratiques et les formes de vie du colonisé dans l’obscurité du primitif.
Ce n’est pas tout à fait un hasard si l’on retrouve des décennies plus tard ce peuple qui n’a pas de noms au cœur des émeutes. « Jeunes de banlieue », « enfants issus de l’immigration », « racailles », « sauvageons », nombreux sont les termes qui expriment la difficile capture par les mots de ceux dont le destin tragique prolonge cette histoire innommable. Il conviendra de prolonger l’analyse de la constitution de la communauté abstraite des « jeunes de banlieue ». Tout en notant que cette catégorie ne recouvre globalement pas une réalité stable – tous les jeunes qui habitent en banlieue ne sont pas des « jeunes de banlieue » – on s’intéressera à la constitution de ce groupe minoritaire dont l’émeute peut-être considérée comme l’un des rites d’identification. Si elle est largement alimentée par les fantasmes et les préjugés discriminatoires, si ses frontières sont floues, on ne pourra faire l’économie du constat que l’identité « jeunes de banlieue » forme une partition effective au cœur de la jeunesse, de celle qui vient « gâcher » les manifestations les plus légitimes – comme celle qui s’opposa il y a quelques années au CPE, par exemple. On gardera aussi à l’esprit que l’émotion suscitée par la mort des jeunes de Clichy-sous-bois consolida de façon plus évidente une communauté de destins tragiques – selon un principe d’identification – qu’elle ne suscita l’indignation de la société française dans sa globalité à l’endroit du meurtre d’enfants. Il ne s’agit plus de jeunes – figures sacrés de la République – mais bien de ces jeunes-là. Notons que la séparation de ce groupe particulier du reste de la société ouvre comme pour les sorcières la possibilité d’appliquer des lois d’exception.
Ainsi se forge le début des traits communs à nos deux figures d’étude – l’émeutier et la sorcière – dont la déliaison sociale se traduit invariablement par la fabrique d’un nom par défaut et une disqualification des pratiques cachées au service d’une société de la surveillance qui place paradoxalement le visible au centre de son propre dispositif de dissimulation. Le théâtre des émeutes de 2005 en se situant au cœur des quartiers populaires – au contraire des émeutes dans les centres-ville de la Capitale, par exemple – conclue la définition d’une situation particulière qui brille pour sa part par son régime d’absence : des hommes qui n’ont pas de noms, acteurs d’une situation qu’on ne saurait nommer dans un lieu sans qualité – qui échappe totalement au statut de ville.
L’émeute de/en banlieue est un jeu de soustraction, son principe actif est une extrême tension vers un moment qui s’échappe du régime du dicible et en même temps – et ce n’est pas le moindre des paradoxes de son écho médiatique – de celui du visible.
Si nous revenons maintenant à la manifestation, nous voyons combien l’écart est remarquable avec les principes qui président à l’émeute. Nous l’avons dit, cette dernière ne répond à aucune forme de mobilisation militante, c’est-à-dire à aucune projection dans un horizon au-delà de l’évènement lui-même. Pour reprendre le motif proposé par Philippe Pignarre et Isabelle Stengers (7), il s’agit plus d’une recette que d’une théorie, c’est-à-dire plus d’une pratique que d’un projet. Ce qui a notamment des conséquences sur sa forme, son dess(e)in. Là où la manifestation contemporaine est un cortège, un parcours d’un point symbolique à un autre, une prise de la ville qui en emprunte cependant les principes urbains les plus significatifs – en épousant notamment le tracé des avenues – l’émeute déchire littéralement la ville. C’est une striation au sens de Deleuze et Guattari qui dessine comme jadis les skatters – d’avant les skate-parcs – des trajectoires invisibles dans le motif urbain. Un évènement informe qui échappe à la réification même s’il s’inscrit dans le rituel et convoque ainsi le répertoire des malices et des savoirs illicites accumulés par une communauté provisoire reliée par une dynamique transgressive. Là où la manifestation propose un rapport de force guerrier, une ligne de front où le nombre produit le sens comme la légitimité, l’émeute s’enfuit sans cesse de la réification, elle n’avance pas et ne va nulle part. Elle oppose au rapport de force un principe d’inquiétude par soustraction des corps. Elle fait littéralement le vide et occupe volontiers le territoire de la nuit, espace du fantasme et de la transgression. Il faudra s’étendre plus qu’il n’est possible dans ce contexte sur toutes le conséquences de ce penchant nocturne qui relie significativement l’émeute de banlieue à des rituels de magie et retourner ainsi notre lecture du corps invisible qu’elle met en scène. Notons dès à présent que l’émeute n’offre aucune prise, ni dans ses formes ni dans ses mots et encore moins à l’endroit de ses acteurs dont la furtivité est peut-être la caractéristique qui les inscrit le plus significativement dans le contemporain.
Et c’est donc à un spectacle paradoxal que nous ont invités les ouvertures de journaux télévisés et les Unes de la presse. Pendant des semaines, l’émeute a rempli l’écran de son vide. Que voyons-nous ? Des feux dans la nuit, des jeunes insaisissables et sans visage, des corps agiles qui disparaissent à souhait dans l’obscurité ou derrière des écrans de fumée selon des recettes pour s’évaporer dont nous ne savons rien. Quelque chose qui se refuse à la prise mais qui crée un piège fascinant d’inquiétude. Une possession. Comme tout rituel magique, l’émeute est un moment fugace de perception de l’invisible. Elle correspond à un instant d’intensification, à une charge. Soudain s’élève le niveau de perception et nous voyons, comme surgissant de nulle part, un autre espace social avec ses connivences, un moment où s’agrège tout ce qui a été produit en secret, pratiques illicites comme celles des sorcières dont le mode de transmission – comme dans tout rituel – s’inscrit d’abord dans une pratique, une performance. Il faut engager son corps pour recevoir cette connaissance qui ne se prononce pas. À se tenir en dehors, on ne comprend littéralement rien. C’est une pensée par l’expérience. Comme le rite vaudou révèle la nuit venue l’étonnante pulsation d’un autre monde tu et dissimulé le jour, l’émeute n’est pas ainsi une rupture mais comme nous essayons ici de l’imaginer, une communauté secrète qui se révèle brièvement avant de retourner à son anonymat. Le corps fantomatique de ces jeunes encapuchonnés est ce corps anormal qui comme l’enfant hippopotame du récit de Tobie Nathan (8) nous avertit qu’un autre monde existe, au-delà du visible. À l’autiste de Nathan comme au jeune de banlieue on réserve cependant la même mise à l’écart car il ne nous dit rien, rien qui puisse trouver sa place dans notre système de pensée. C’est pourtant à cette singularité qu’il me semble urgent de faire une place.
Du devenir sorcière
Pour venir maintenant à cette idée de sorcière, il me faut repasser par la proposition de Philippe Pignarre et Isabelle Stengers de déclarer le capitalisme « système sorcier sans sorciers » (9). Y revenir pour peut-être en déplacer quelque peu la perspective. « La sorcellerie capitaliste » de Pignarre et Stengers est littéralement un exercice de désenvoûtement. Nommer les principes et les acteurs d’un système sorcier qui littéralement nous agit. « Afin de dramatiser le “nous ne savons pas”, nous avons pris le risque de nommer le capitalisme “système sorcier sans sorciers”. Il s’agit d’un nom, pas d’une théorie. Nommer est un acte qui suscite la pensée et le sentir – c’est pourquoi nous ne sommes pas prêts d’abandonner le nom “capitalisme” – et en l’occurrence il s’agit de tenter de susciter un rapport attentif – il faut toujours être attentif lorsqu’il y a opérations sorcières – à toute référence naturelle, légitime fondant un jugement qui trie, c’est-à-dire à tous les types de “nous savons” que suppose le tri. » Le principe magique que décrivent les auteurs à l’endroit du capitalisme est de l’ordre de l’emprise spécifique qu’il exerce et du talent qu’il développe à contourner les objections et les attaques, en combattant sans faire front, en contraignant sans laisser prise. Leur perspective est d’apprendre à se protéger en tentant d’identifier ce qui nous rend vulnérables à cet ensorcellement et en le nommant.
Je voudrais reprendre à mon compte cette idée en la retournant, considérant que l’une des parades à ce système capitaliste pourrait bien être de se situer dans l’innommable, c’est-à-dire de résister comme il le fait lui-même à la saisie en développant des pratiques qui échappent à ce désenvoûtement, pratiques opaques, opérations multiples et sans tête, transmissions du savoir, de la ruse et des recettes à ses pairs sans passer par un mode déclaratif mais en restant dans celui d’un rite impliquant une co-présence des acteurs qui performent une communauté. C’est dans ce régime que je me propose de penser la puissance particulière des émeutes comme celles de l’année 2005 et d’inscrire ses auteurs dans un devenir sorcière. Pourquoi préférer le terme sorcière à celui de sorcier ? D’abord parce que le sorcier est un titre inscrit dans l’ordre social. Au côté du chef, il est l’intercesseur privilégié entre le visible et l’invisible, le dépositaire des médecines et des rites. Il n’en va pas de même avec la sorcière. Le déplacement vertigineux que provoque ici le passage d’un genre à un autre est un phénomène qui vaudrait à lui seul une longue étude. Retenons ici que le terme sorcière n’est pas un titre mais bien une tentative de saisie par un pouvoir de ce qui lui échappe. Ce qui échappe à l’ordre social et sexuel – la femme qui vit seule – mais aussi à l’économie capitaliste – le retrait, l’automédication, l’autogestion, la culture de subsistance.
Ainsi à celle qui se tient hors de portée de la saisie capitaliste, on jette un sort en même temps que l’opprobre en en faisant une sorcière, un être malveillant comme on fait le récit des terribles mœurs des « sauvages » d’hier et d’aujourd’hui. Aussi le devenir sorcière s’inscrit comme expression invariable de la marginalité innommable. On dira que « ce jeune homme est devenu sorcière » pour exprimer sa force insaisissable, son pouvoir insondable mais peut-être aussi son extrême solitude, son détachement définitif du corps social majoritaire. On créera ainsi un invariable féminin, manière de proposer un premier outil à l’immense chantier que présuppose une Histoire de l’innommable.
Au contraire donc du mot sorcière qui apparaît comme disqualification et à la fois capture de celle qui échappe, le devenir sorcière que nous proposons n’est pas une saisie. Nous ne fixons ici aucun objet. Il s’agit plutôt d’un mouvement, sans idéologie, un mouvement de pratiques, de recettes dont on aura compris qu’elles convoquent et sollicitent un corps échappé du conformisme.
Adresser ce devenir sorcière à l’endroit des émeutiers de banlieue partant du principe que leurs manifestations (nous) échappent est propre à jeter un trouble. Mais c’est bien de ce trouble dont nous cherchons à traduire l’effet. Féminiser ainsi une situation dont on a vite fait de penser qu’elle n’est qu’un dérivé de l’art masculin de la guerre, c’est aussi tenter de la recevoir autrement et d’ouvrir l’hypothèse d’un genre indéfini qui serait l’attribut de ce corps étranger – celui de l’émeutier comme celui de la sorcière – devenu, par une science inconnue, insaisissable, c’est-à-dire autrement et positivement invisible. La sorcellerie que nous convoquons ici nous est ainsi précieuse par son obscurité. Prendre soin de l’obscurité nous paraît pouvoir être un projet politique ambitieux en même temps qu’une écologie nécessaire. Prendre soin de ce nous ne voyons pas, des espaces d’où peuvent surgir ce (et ceux) que nous ignorons, c’est une autre manière de nommer ce rapport attentif que convoque Isabelle Stengers. Un soin pour l’espace vacant, pour l’espace des lisières, une sympathie pour l’ombre. On ne délogera donc pas ici la sorcière du fond de son bois pour l’exposer à la lumière, mais on conservera plutôt la qualité opaque de son écosystème qui fait obstacle à la violence d’un présent sans horizon, ni secret, à l’illusion de la transparence qui n’est autre chose qu’un nouvel avatar de la dissimulation du pouvoir qui nous agit. (10) Nous nous garderons bien de réifier la sorcière, d’en faire une héroïne, un modèle – fut-il contestataire. Elle restera ici un horizon, un devenir, adjectif plutôt que nom, féminin mais définitivement singulier. Méthode pour disparaître avant d’être pris, mais aussi pour surgir sans annonce et faire retour. Le devenir sorcière comme signe d’une Histoire secrète qui revient, d’un envoûtement de l’Histoire, une hantologie.
« L’émeutier et la sorcière » est paru dans le catalogue « Sorcières, pourchassées, assumées, puissantes, queer » édité par Anna Colin (Editions B42 et Maison Populaire) à l’occasion de sa série d’expositions « Plus ou moins sorcières » en 2012 à La Maison Populaire.